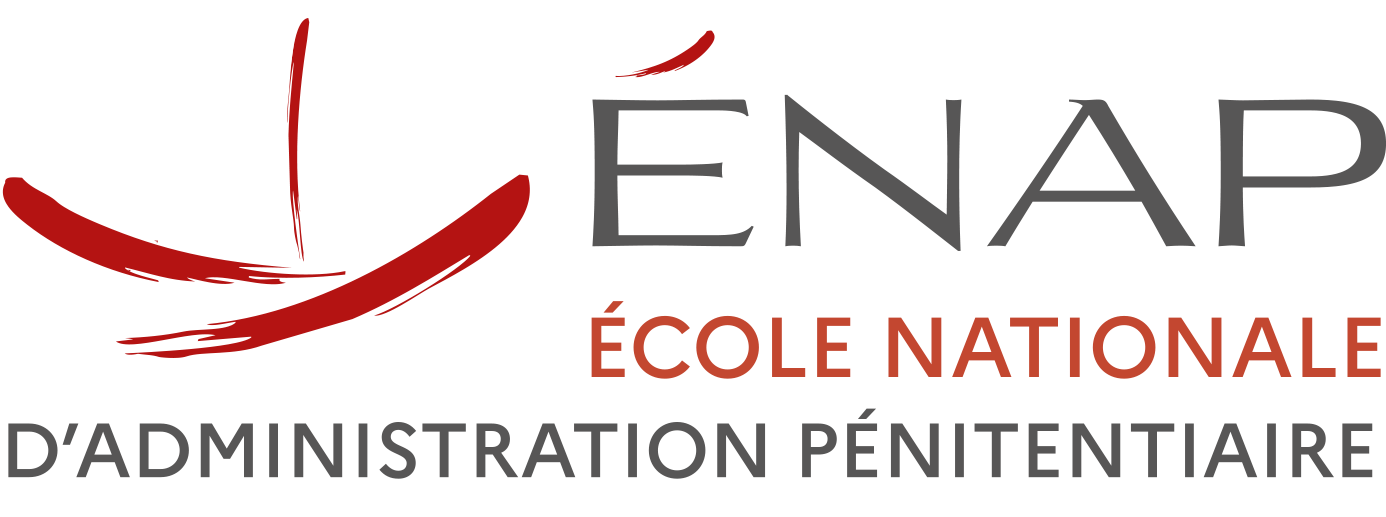Les peines en débat

Les aménagements de peine
Les aménagements de peine sont présentés comme des progrès de la science pénitentiaire et des tournants dans la pratique judiciaire de l'époque. La loi du 14 août 1885 instaure la libération conditionnelle qui accorde, pour bonne conduite en prison, une diminution de peine de moitié pour les peines supérieures à 3 mois, même pour les récidivistes. C'est une faveur de l'administration qui peut être révoquée, et non un droit. Autre nouveauté : les sociétés de patronage sont chargées de veiller sur la conduite du libéré. En 1912, sera créée la liberté surveillée. Pour éviter la prison, considérée comme cause de la récidive, la loi du 26 mars 1891 (Loi Bérenger) crée le sursis à l'exécution de la peine en cas de première condamnation à la prison. Le condamné, s'il commet une nouvelle faute dans les 5 ans, exécutera alors sa peine sans confusion avec la suivante. Si la réhabilitation du détenu existe en droit depuis la révolution, la loi du 14 août 1885 va la moderniser en effaçant la condamnation et le fait lui-même du casier judiciaire, et ce même en cas de récidive. On s'interroge alors aussi sur la notion de responsabilité et sur la distinction entre folie et criminalité. En 1905, la Circulaire Chaumié incite à atténuer les peines des « demi-fous ».
En 1906, un premier projet de loi d'abolition est porté par le gouvernement en place devant la chambre des députés mais l'affaire Soleilland, l'année suivante, grâcié par Fallières en 1907, va attiser la colère de l'opinion publique qui désapprouve cette décision et va relancer le débat.