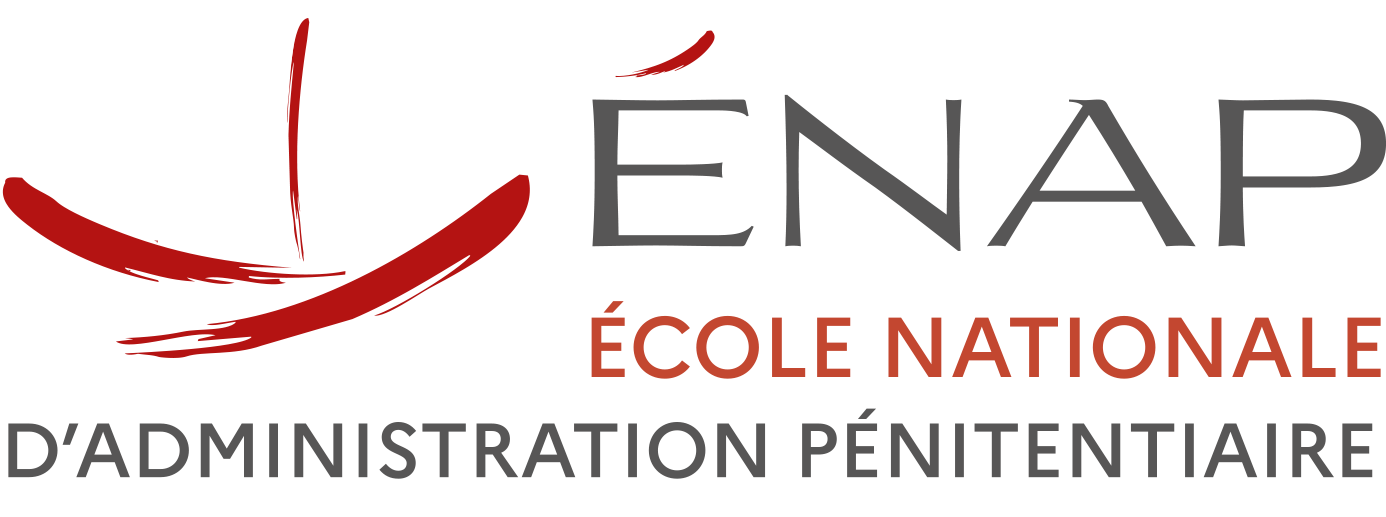Axes de recherche
Les recherches du Cirap s’inscrivent dans une tentative d’analyse du champ pénitentiaire en faisant le choix théorique d’interroger les dispositifs et les pratiques. Cette approche permet de ne pas tomber dans l’écueil de considérer la population pénale comme une catégorie par nature au risque d’essentialiser une condition de déviant. Ainsi, partir des dispositifs et des pratiques dotent les recherches d’instruments d’analyses pour éclairer les rationalités politiques à l’œuvre, les contextes d’action mais aussi les logiques des acteurs, leurs expériences et leur vécu. Cette posture permet donc d’analyser les rationalités politiques, sociales, professionnelles et les pratiques, mais aussi de rendre compte et surtout de comprendre la constitution des subjectivités.