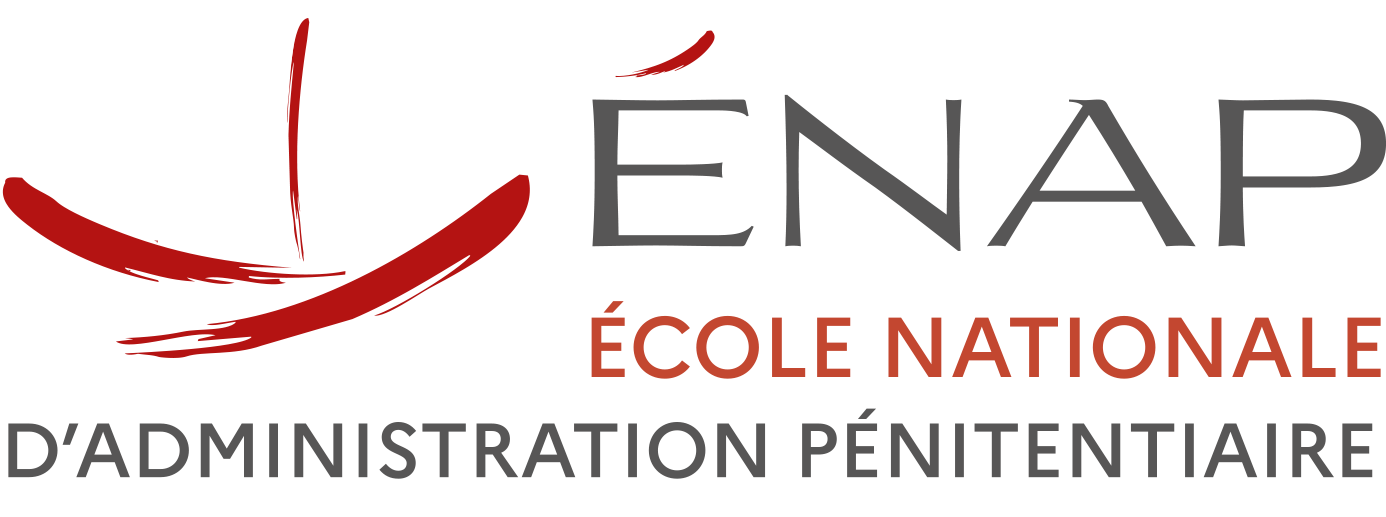L’ÉNAP aux 28e Rendez-vous de l’Histoire de Blois
Pour la troisième année consécutive, l’ÉNAP était présente aux 28e Rendez-vous de l’Histoire de Blois. C’est dans la salle des assises du tribunal de Blois que le Centre de ressources sur l’histoire des crimes et des peines (CRHCP) a présenté un atelier pédagogique intitulé : « Les prisons de la colère. Mutineries et conséquences (1971-1975) ».
Fabienne Huard-Hardy et Mickaël Boyer ont pu revenir sur cette période bien particulière de l’histoire pénitentiaire. S’inscrivant dans un contexte de révoltes à l’international, comme celle de la prison d’Attica (1971), les mutineries en France ont leur spécificité, liée en partie à l’affaire de Clairvaux (21-22 septembre 1971) qui endeuille le personnel pénitentiaire et traumatise l’opinion publique. « Pas de sang, pas d’évasion, pas de Clairvaux », tel est le mot d’ordre lancé par les détenus lors de la mutinerie de Toul (hiver 1971) : ils sont en effet conscients qu’en cas de débordements violents, leurs revendications pour une amélioration des conditions de détention risqueraient de ne pas être entendues.
Qu’est-ce qu’est une mutinerie dans un contexte pénitentiaire ? Quelles en sont les enjeux ? Il ne s’agit pas seulement d’une bataille médiatique. Les témoignages recueillis par le Groupe d’information sur les prisons (GIP) organisé autour de Michel Foucault, participent à mettre en lumière un sujet longtemps resté à l’écart du débat public. La crise questionne les Français sur la prison, et entraîne une réflexion pour une réforme pénitentiaire. Voulue par le président Valéry Giscard d’Estaing, et portée par la secrétaire d’État à la Condition pénitentiaire Hélène Dorlhac, cette réforme trouve son aboutissement en 1975.
Chaque thématique développée par les intervenants a été introduite par un document original (caricature, photographie, affiche ou reportage télévisé) dont la description et la contextualisation ont permis au public de se saisir du sujet. Cette méthode a aussi permis de montrer toute la richesse du fonds documentaire du CRHCP.
Les nombreux échanges à l’issue de l’atelier ont permis aux intervenants de répondre à la curiosité et l’intérêt du public pour les thématiques pénitentiaires.